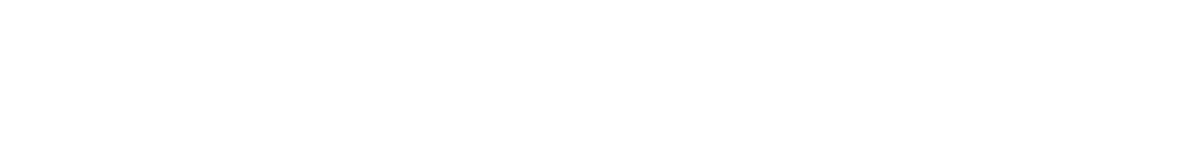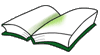|
Résumé :
|
En prenant racine sur une typologie des groupe sociaux en Afrique, considérés sous l'autel des processus historiques à l'origine de certains invariants (éléments de différenciation, hiérarchisation sociale...), Mbodj investit une perspective éminemment libératrice avec des propos incisifs mettant à nu les effets pervers, sur le Social, du néolibéralisme, un modèle, imposé par l'Occident aux sociétés africaines, structuré autour du concept d'injustice comme en atteste l'expression de Hobbes Mbodj est d'autant plus fondé à s'engager dans une perspective de déconstruction / reconstruction qu'il remarque la survivance du legs colonial à travers la présence du même dispositif de politique sociale dans les pays partageant l'usage de la langue française. Ce legs concerne aussi les modes de transmission avec le passage, dans la gestion des problèmes sociaux, des solidarités imposées (liens de sang, tradition, loi) aux solidarités choisies (droits revendiqués, entités dissidentes...) domestiquées dans le cadre d'un semblant de protection sociale. L'intérêt du travail de Mbodj est, de ce point, de vue incommensurable car l'approche qu'il développe permet d'avoir, à la fois, une vision diachronique et synchronique du Social en Afrique et, mieux encore, ouvre des perspectives intéressantes sur le futur référentiel des politiques sociales en Afrique noire francophone. L'auteur le fait avec une qualité de démonstration très rare alliant une fluidité de langue, une érudition sans ésotérisme et une profondeur dans l'analyse, soit autant d'atouts lui permettant de dégager un fil conducteur qui guide le lecteur, profane ou spécialiste de la question sociale, à travers les méandres de sa pensée féconde
|